21 novembre 1893 dans le 14ème arrondissement de Paris – mort pour la France le 30 octobre 1915 à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne).
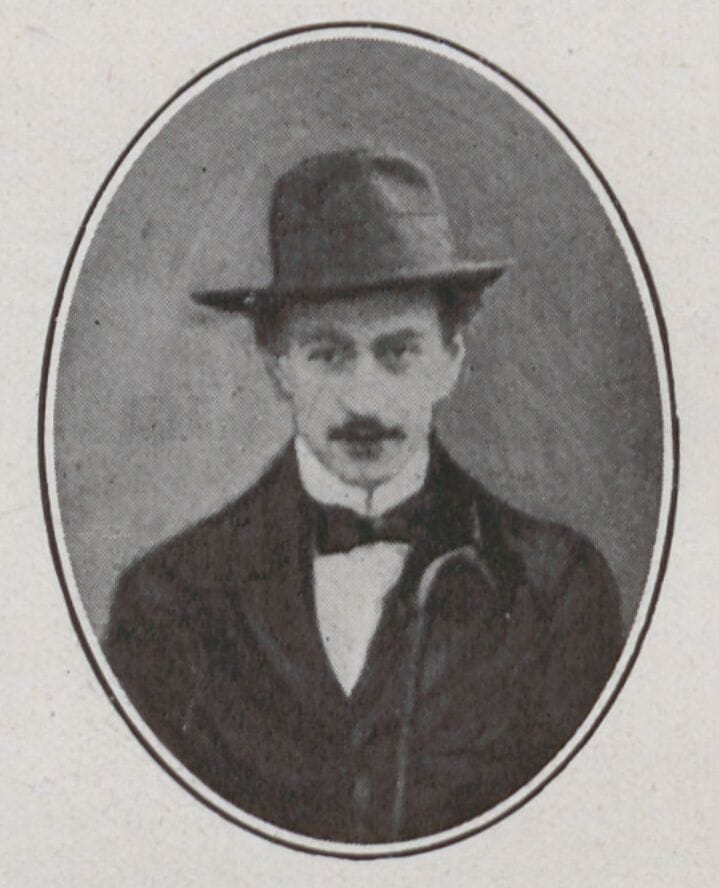
Henri Lagrange est le fils d’Eugène Napoléon Philibert Lagrange, employé, et de Claire Marie Eugénie Leroy, sans profession[1]. En 1910, Henri Lagrange publie son premier article « Jean Christophe et M. Romain Rolland » dans la Revue critique des idées et des livres, ce qui lui vaut d’être remarqué simultanément par Maurice Barrès et Romain Rolland[2]. Il s’occupe durant un temps de la revue des revues à La Revue hebdomadaire. Entre 1910 et 1913, il rejoint l’AF et prend une part active « aux réunions publiques que l’AF organisa dans les faubourgs de Paris […] et dans lesquelles toujours après avoir parlé, il fallait être prêt à se battre »[3]. D’après Maurras, le jeune militant « avait embrassé la cause de l’Action française “comme on entre en religion” » [4]. À dix-sept ans, il est emprisonné le 23 juin 1911 pour avoir crié « À bas Fallières ! À bas la République ! », au passage du cortège du président de la République à Rouen . Il est condamné à six mois de prison pour outrage au président de la République et n’est libéré que le 8 novembre 1911[5]. Quoique son délit fût d’ordre politique, il est mis en cellule sous le régime du droit commun. Le 13 décembre 1911, il initie la première réunion du Cercle Proudhon avec Georges Valois. Avec les Étudiants d’AF, il fait retirer le droit de vote aux étudiants étrangers à l’Association générale des Etudiants de Paris le 11 mars 1913[6]. Le mois suivant, il affronte des étudiants des Beaux-Arts à coups de canne à l’angle de la rue Bonaparte et de la rue Visconti dans le 6ème arrondissement de Paris[7]. Suite à cette affaire, il est condamné le 10 juin suivant, par la 11ème chambre correctionnelle de Paris, à deux cents francs d’amende pour port d’arme prohibé ainsi que coups et blessures. La même année, il devient secrétaire général des Étudiants d’AF[8]. Le 17 mars 1914, il est arrêté près du café Cardinal, au cours de la grande manifestation qui se produisit sur les grands boulevards, à la nouvelle de l’assassinat du journaliste Gaston Calmette par Henriette Caillaux, l’épouse du ministre des Finances[9]. Henri Lagrange aurait frappé un agent avec une chaise. Fernand d’Harmenon en aurait fait autant avec un bock et Jean Gibelin avec une canne. Ce dernier reçoit six jours de prison, Fernand d’Harmenon est acquitté et Henri Lagrange est condamné à six jours de prison et cinquante francs d’amende pour violences aux agents. Il est exclu de l’AF avec son acolyte Raymond Tournay le 5 juin 1914 pour dérive activiste[10]. Quelques jours avant sa mobilisation, il se rend aux bureaux de l’Action française, rue Caumartin, pour se réconcilier avec ses anciens amis. À son grand dam, il ne fut pas reçu, et partit en claquant les portes et en hurlant : « Salauds ! »[11]. Henri Lagrange s’engage en août 1914 et est incorporé au 103ème RI[12]. Promu caporal le 10 novembre 1914, il se porte volontaire pour combattre en Alsace mais doit encore se morfondre des mois au dépôt d’Alençon. Finalement, le 8 mars 1915, il est envoyé sur le front de Champagne. Du fond des tranchées, il lit Dante, Racine et « son inamovible Manuel du Chrétien »[13]. Dans sa correspondance, il fait état de sa résignation complète à la guerre : « C’est aux intellectuels du nationalisme, qu’il appartient de donner l’exemple… les obus et les balles sont physiquement moins difficiles à supporter que les coups de canne »[14]. Combattant exemplaire, il est élevé au grade de sergent le 5 août 1915 puis à celui d’adjudant le 5 octobre après avoir été blessé le dit jour[15]. Huit jours avant de mourir, il croise « un de ses compagnons d’émeute, le chansonnier Maxime Brienne » [16]. Les deux avaient fondé le journal Leurs Figures avec André Blot en 1912. Henri Lagrange succombe à ses blessures de guerre le 30 octobre 1915 à l’hôpital civil de Montereau tout ayant retrouvé la foi. En tout, Henri Lagrange est honoré de trois citations à l’ordre de l’armée[17]. Dans la préface de son ouvrage posthume Vingt ans en 1914 (1920), Maurras lui rend hommage comme étant l’un des « princes de la jeunesse » du Quartier latin, « toujours une canne et un livre dans la poche »[18]. Georges Bernanos évoque son souvenir en faisant dire à l’un des personnages de son roman Sous le soleil de Satan (1926) : « J’ai vu tout frémissant d’une impatience sacrée, le jeune Lagrange pareil à un pressentiment vivant… Il goûte avant moi le repos qu’il a détesté ».
[1] Acte de naissance n°7125 d’Henri Eugène Georges Lagrange du registre des naissances de l’année 1893 du 14ème arrondissement de Paris, Archives de Paris, V4E 9613.
[2] La Revue critique des idées et des livres, avril-juin 1910, p. 53-82.
[3] Almanach de l’Action française, 1919, p. 185-186.
[4] Pierre Andreu, « Demain sur nos tombeaux », Combat, n°4, 10 avril 1936, p. 7.
[5] L’Action française, 9 novembre 1911.
[6] Ibid., 12 mars 1913.
[7] Ibid., 11 juin 1913.
[8] Rosemonde Sanson, chap. « Les jeunesses d’Action française avant la Grande Guerre », dans M. Leymarie (dir.) et J. Prévotat (dir.), op. cit., p. 205-215.
[9] L’Action française, 31 mars 1914.
[10] Ibid., 18 juin 1914.
[11] E. Weber, op. cit., p. 96.
[12] Registre matricule de la classe 1913 du n°2001 au n°2500 du 3ème bureau de la Seine, Archives de Paris, D4R1 1746.
[13] L’Intransigeant, 13 novembre 1915.
[14] Henri Lagrange, Vingt ans en 1914, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1920, p. 218.
[15] L’Action française, 18 juin 1914.
[16] Maurice Barrès, Les diverses familles spirituelles de la France, Paris, Plon, 1930, édition définitive, p. 132.
[17] L’Action française, 5 novembre 1915.
[18] C. Maurras, « Henri Lagrange » dans Tombeaux, op. cit., p. 136-144.