La presse

Le 21 mars 1908, la Revue d’Action française évolue en un quotidien, L’Action française, sous-titré « organe du nationalisme intégral ». Avant la déclaration de la guerre, L’Action française incarne le courant royaliste et peut compter sur tout un réseau de sections et de soutiens disséminés aux quatre coins de l’hexagone. Les ligueurs et Camelots du Roi font l’objet d’une surveillance étendue par les autorités républicaines en tant que farouches opposants à la Troisième République. Lorsque le Deuxième Reich déclare la guerre à la France le 3 août 1914, l’Action française se rallie sans délai à l’union sacrée en vigueur, privilégiant ainsi la sauvegarde de la nation plutôt qu’un coup de force monarchique hypothétique. Ce ralliement circonstanciel à la République exaspère une frange du lectorat de L’Action française se plaignant du ton éditorial devenu plus tempéré à l’égard des autorités républicaines. Peu importe, l’Action française fait bloc, gagne même de nouveaux adhérents et renforce sa légitimité politique au fil du conflit au point d’inquiéter les autorités devant ses différents succès . Le 29 août 1914, le journal L’Action française inaugure une nouvelle rubrique intitulée « L’Action française au champ d’honneur » composée de courtes notices de royalistes pour les cinq motifs suivants : morts pour la France, disparus, blessés, cités et promus. Ces notices sont toujours introduites d’un alexandrin tiré de La France bouge[1] :
« Demain sur nos tombeaux,
les blés seront plus beaux ».
Le ton éditorial est volontairement stéréotypé conformément aux codes de l’éloge funèbre. Les renseignements sont fournis directement par les familles, les compagnons d’armes ou les communications des sections. Les textes sont d’abord rédigés par Maurice Pujo, membre du comité directeur de l’Action française et collaborateur invétéré de Maurras, jusqu’à ce qu’il soit mobilisé sur le front[2]. Le 19 avril 1915, Jules Challamel prend la suite de Maurice Pujo[3].
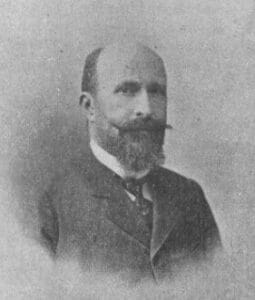
Le 19 décembre 1914, la rubrique « L’Action française au champ d’honneur » se plie aux contraintes de la censure militaire et ne doit plus indiquer les noms des combats où sont tombés les morts et blessés tombés au champ d’honneur. Il en est de même pour les listes de disparus[4].
Durant l’année 1917, les exigences de l’actualité forcent le journal à espacer le compte-rendu des faits d’armes de ses héros en lui préférant « des pages supplémentaires de 10 ou 12 colonnes comprenant jusqu’à 60 ou même 100 notices individuelles »[5]. La crise du papier n’arrange rien et le quotidien passe de quatre à deux pages engendrant un important arriéré de noms à diffuser. Celui-ci contraint le journal à éditer à de multiples reprises des numéros spéciaux pour régulariser la situation à l’exemple des numéros du 2 novembre 1916, du 21 janvier 1917 et du 29 août 1917 où plusieurs centaines de noms sont inscrits. Le retard provoque la frustration de certains lecteurs contraints de patienter des semaines voire des mois devant « l’intarissable liste » que Jules Challamel met à jour tant bien que mal[6]. Maurras ironise d’ailleurs sur cette situation[7] :
« […] ces vivants et ces morts vont plus vite que la plume chargée de faire leur histoire ».
Pourtant, ce retard n’est pas du seul fait de Jules Challamel. En effet, les prescriptions officielles de l’État ordonnent la cessation de la publication des listes de soldats morts au combat pour préserver le moral de l’opinion publique à l’arrière. L’Action française contourne l’interdiction en mentionnant « les défunts issus de la noblesse dont la notoriété […] rend l’occultation plus compliquée »[8]. Les journaux conservateurs mettent l’accent sur « le caractère massif des décès dans les rangs nobiliaires »[9].
[1] Chanson royaliste et antisémite considérée comme le chant d’assaut des Camelots du Roi.
[2] L’Action française, 18 avril 1915.
[3] Albert Marty, L’Action française racontée par elle-même, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1968, p. 160.
[4] Id., Ibid., p. 160.
[5] L’Action française, 21 mars 1920.
[6] Ibid., 22 janvier 1917.
[7] C. Maurras, Tombeaux, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1921, p. 145-148
[8] Bertrand Goujon, Du sang bleu dans les tranchées. Expériences militaires de nobles français durant la Grande Guerre, Paris, Vendémiaire, coll. « Chroniques », 2015, p. 473.
[9] Id., Ibid., p. 473.